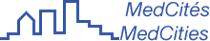GUIDE
pour l’élaboration des Stratégies de Développement des Villes
Chapitre 8 La mobilisation des moyens financiers pour la mise en œuvre du plan d’action de la SDV
8.1 Objectifs et préalables :
8.1.1 Définition
La mobilisation des moyens financiers, comme activité transversale qui couvre l’ensemble du processus SDV, est l’ensemble des actions que doit mener la ville pour réunir les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du plan d’action de la SDV. Cette mobilisation est constituée d’un plaidoyer de la ville pour la levée de fonds nécessaires et l’élaboration d’un cadre contractuel correspondant pour la réalisation des projets.
8.1.2 Objectifs
- Mobiliser les ressources nécessaires pour conduire le processus analytique de la SDV et réaliser les actions prévues dans le plan d’action,
- Réussir la mise en œuvre du plan d’action pour crédibiliser la démarche SDV,
- Crédibiliser l’action de la ville vis-à-vis de sa population et maintenir l’adhésion des parties prenantes à la démarche SDV.
8.1.3 Préalables
- La SDV et son plan d’action sont formellement approuvés et institutionnalisés,
- La ville démontre sa crédibilité à travers la qualité de conduite du processus de la SDV et l’engagement de réformes des finances locales. Ceci donne des gages pour l’engagement des administrations centrales (ministères des finances) et des bailleurs de fonds internationaux,
- Le lobbying auprès des parties potentiellement concernées par le financement (vendre l’idée et le processus de la SDV).
8.2 Déroulement des activités :
8.2.1 Les principales tâches à engager et les acteurs
Avant que la ville par le biais de son chef de file (le maire, le wali ou le gouverneur) n’entame les négociations avec les différents bailleurs de fonds publics et privés, il faut :
- Actualiser l’inventaire des ressources disponibles ou potentielles et les acteurs qu’il faut solliciter pour la réalisation des projets du plan d’action non encore pourvus de financement.
- Elaborer une stratégie d’approche de ces acteurs qui prenne en compte la communication sur la SDV et la spécificité des différents bailleurs de fonds.
Concrètement, la ville est appelée à faire son plaidoyer pour la mobilisation des fonds nécessaires à la concrétisation de la SDV auprès des collectivités locales (communes, province, région), des services et organismes de l’Etat, des organisations gouvernementales ou non gouvernementales nationales ou étrangères et du secteur privé.
Au niveau communal, la ville doit donner l’exemple en procédant à :
- L’augmentation de ses ressources propres par la mise en œuvre d’une stratégie de mobilisation du potentiel fiscal notamment la révision de l’assiette fiscale et la récupération des «restes à recouvrer» en matière de fiscalité locale,
- La mobilisation des ressources d’opérateurs économiques et des populations ayant (ou qui vont) bénéficié (er) des retombées positives prévues par le plan d’action,
- La mobilisation de la coopération décentralisée par une large diffusion de la SDV auprès des collectivités locales étrangères qui sont en relation avec la commune ou qui sont intéressées par la coopération décentralisée,
Au niveau provincial, régional et national, la mobilisation des moyens dépend des relations administratives et de tutelle qui existent entre ces différentes entités. En général dans les PSEM, les villes ont une faible marge de manœuvre, toutefois l’existence d’un leader ou d’un groupe de pression contribue énormément à attirer vers la ville des investissements publics importants. La ville doit donc s’organiser de manière à faire entendre sa voix grâce à des «task forces» formées de personnalités qui plaident en faveur de la SDV. Ces «task forces» peuvent être organisées sous forme d’ONG nationale. Les liens entre cette ONG et la structure de mise en œuvre de la SDV doivent être étroits.
8.2.2. Les moyens, les techniques et outils
- Lobbying et techniques de négociation avec les autorités centrales et les bailleurs de fonds,
- Contractualisation public-privé,
- Médiatisation de la SDV et mise en place d’un comité de surveillance composé de représentants du secteur public, du secteur privé et des groupes communautaires,
- Mise à la disposition des secteurs public et privé des fiches projets issues du plan d’action de la SDV dans la perspective qu’ils les intègrent dans leurs préoccupations ou éventuellement dans leurs programmes,
- Recours à des agences spécialisées de communication pour médiatiser l’entrée dans la phase de mise en œuvre.
8.2.3 La validation et la consécration des résultats
- Le comité de surveillance valide les budgets et leurs affectations,
- Présentation publique des projets réalisés sur la base des budgets disponibles après validation et forum de discussion,
- Examen de l’état des réalisations, des plannings des travaux, des écarts éventuels et des propositions de mise à jour sur la base des rapports périodiques élaborés par la structure de mise en œuvre.
8.2.4 Les résultats escomptés
- La mise en œuvre connaît une dynamique soutenue grâce à une mobilisation progressive et prévisible des ressources,
- Les résultats atteints sont visibles et renforcent la crédibilité de la SDV,
- Les mises à jour et corrections au processus de mise en œuvre sont faites dans les délais,
- La SDV est portée par des « champions » reconnus et respectés dans la ville,
- La SDV est acceptée comme un instrument de développement et une référence pour les actions sectorielles.
8.3 Spécificités des PSEM et réponses à apporter à ces spécificités :
8.3.1 Quelques caractéristiques propres à certains PSEM
En général, dans les PSEM, la mobilisation de fonds par les villes pour la réalisation des projets de développement est difficile pour plusieurs raisons :
- Les villes sont en général soumises à une lourde tutelle de la part de l’Etat, dans un contexte de faible déconcentration et décentralisation, ce qui réduit énormément leur autonomie financière.
- La réalisation d’une part importante des projets figurant dans les plans d’actions de la SDV (construction d’hôpitaux, d’écoles, de centres culturels, etc.) relèvent toujours de l’autorité des services et administrations centrales. De ce fait la réalisation de ces projets, malgré leur pertinence, reste souvent aléatoire sauf, naturellement, s’ils sont déjà en cours ou programmés par les instances centrales indépendamment du processus de la SDV.
- La non institutionnalisation des SDV fait que les projets figurant dans les plans d’action ne sont opposables ni à la commune ni à l’Etat.
8.3.2 Les difficultés et risques à surmonter
- Les capacités financières des villes sont souvent faibles, la quasi totalité des budgets est consacrée au paiement des salaires des fonctionnaires des communes et à la gestion courante ;
- La gestion des finances des villes est soumise à une réglementation rigoureuse qui leur interdit, de façon générale, de contracter des emprunts auprès des bailleurs de fonds nationaux et internationaux.
8.3.3 Les moyens pour surmonter les risques et difficultés dans le contexte des PSEM
- Militer pour l’institutionnalisation de la SDV au niveau national : La SDV, si elle est institutionnalisée, sera un instrument ayant une force légale et permettra la mobilisation des ressources nécessaires à son exécution,
- Développer les créneaux de la coopération décentralisée,
- Développer les ressources propres de la ville par l’amélioration du mode de gestion de la fiscalité locale en inscrivant cette problématique comme un des axes thématiques centraux de la SDV.
- Intensifier les dialogues entre les gouvernements et les organismes internationaux (notamment Nations Unies, Banque Mondiale) et les réseaux de villes (Medcités, CGLU, etc.)